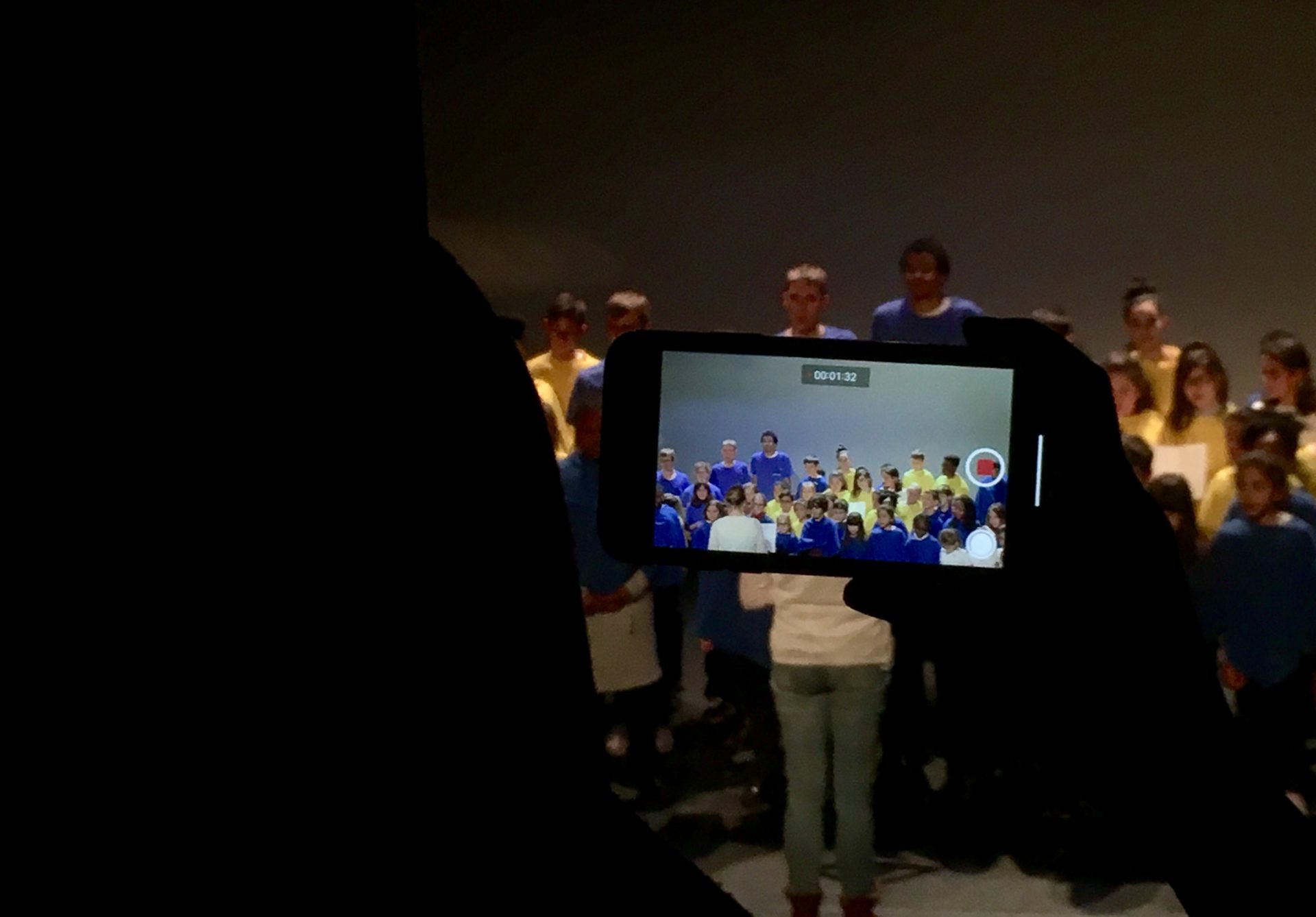PORTRAIT
Depuis le 1er octobre 2019, Stéphane Moniotte, cardiopédiatre, a pris la tête du Département de Pédiatrie des Cliniques universitaires Saint-Luc. Il succède ainsi au Professeur Christiane Vermylen qui occupait ce poste depuis 2011. Par son humour et sa bienveillance apparente, par son professionnalisme et son expérience avérée, l’homme de 46 ans entend bien bousculer l’ordre établi en faisant du bien être au travail un de ses principaux chevaux de bataille. Il insiste aussi : « L’offre de pédiatrie aux CU Saint-Luc est très complète et mérite plus de visibilité et de reconnaissance. »

Chef du département pédiatrique des CUSL depuis peu, cardiopédiatre permanent aux CUSL depuis 2007, Docteur en Sciences Biomédicales depuis plus longtemps encore, auteur de près de 50 articles « peer-rewiewed », père de 4 enfants « formidables », marathonien, vidéaste amateur… C’est à croire que la liste des compétences et des multiples casquettes de Stéphane Moniotte pourrait s’allonger encore à l’infini. L’homme pourtant reste simple, modeste et se raconte de façon drôle et imagée. Ce qui ne l’empêche aucunement d’endosser sa nouvelle fonction de chef avec beaucoup de sérieux et d’investissement.
« Je souhaite aujourd’hui continuer à mettre mon énergie et une vision optimiste au service de notre Département de Pédiatrie, pour contribuer, avec vous, à lui bâtir un avenir digne de son passé et à en faire un lieu d’excellence, traduisant nos valeurs communes. », écrit-il dans un texte décrivant son parcours.
« Être chef n’est pas un but en soi; c’est ce qu’on en fait qui importe »
À ce poste de chef, le Professeur n’avait pas spécialement projeté d’y postuler. Car pour lui, « être chef n’est pas un but en soi; c’est ce qu’on en fait qui importe ». C’est donc seulement au terme d’une longue et mûre réflexion qu’il a finalement saisi l’occasion. Mais avant d’écrire son projet et un dossier de motivation (de 85 pages tout de même), il a d’abord cru bon de rencontrer la majorité des membres du département pour récolter leurs avis sur le futur de la Pédiatrie aux CUSL. Ce qui lui a permis, avant même d’être promu, d’obtenir l’adhésion d’une bonne partie du personnel pédiatrique.
Les priorités : communiquer, faire du lien et faciliter la vie des patients
Lors de notre entretien avec lui, Stéphane Moniotte a évoqué les trois principales raisons qui l’ont motivé à poser sa candidature pour ce poste. Des motivations qui sont aussi des pistes d’améliorations et de modernisations de l’ensemble du département pédiatrique, voire de l’ensemble de l’hôpital.
1. Améliorer la communication et la visibilité du département pédiatrique des CUSL.
« Quand vous cherchez sur Google ‘Hôpital pour enfants Bruxelles’, vous tomber rarement directement sur le site des Cliniques Saint-Luc. Ne pas avoir la visibilité d’être un hôpital pédiatrique est clairement problématique. »
« Par exemple, quand il y a un crash de voitures aux quatre bras de Tervuren à 5 min d’ici et qu’il y a un enfant impliqué, les pompiers, les parents, les ambulanciers… veulent tous qu’on l’emmène en ville et non pas aux CUSL qui a pourtant une offre pédiatrique complète… Cette méconnaissance, autant en interne qu’en externe, est effrayante et aberrante. »
Selon le quadragénaire, ce manque de visibilité est en partie dû à une certaine vétusté du site web de l’hôpital, peu attrayant et peu pratique d’utilisation. Heureusement, l’équipe de communication est en train de plancher sur une nouvelle plateforme plus moderne; à l’image de leur site web destiné aux patients internationaux.
Le nouveau projet de reconstruction et d’agrandissement des CUSL (‘Hôpital 20-25’) sera également une autre possibilité de rendre le département pédiatrique plus visible grâce à sa réorganisation. L’architecture sera complètement différente dans le nouvel hôpital et l’organisation sera pensée en filières (comme la filière mère-enfant); ce qui permettra de mutualiser les ressources et de rapprocher les acteurs qui travaillent main dans la main en terme de trajets de soins, ou de suivi des patients. Par exemple, l’obstétrique, la salle d’accouchement et la néonatologie seront logiquement côte à côte. De même pour la cardiologie, la chirurgie cardiaque et les soins intensifs pédiatriques. Il y aura donc une réorganisation dans la conception et dans les espaces qui permettra d’optimiser les flux de patients dans l’institution et la qualité de la prise en charge en général.
2. Faciliter la vie des patients en contribuant à la mise sur pied d’un « Trajet patient informatisé » (TPI²).
Parmi les challenges qui ont motivé Stéphane Moniotte à « faire ce job », comme il dit, c’est que les CUSL vont passer à un système entièrement intégré et numérisé de gestion de l’hôpital et des patients, nommé ‘Trajet patient intégré et informatisé’ ou TPI². Cette réorganisation en profondeur impliquera une intégration de l’ensemble des applications informatiques existantes à Saint-Luc qui contiennent des données liées aux patients (admission des patients, gestion médicale et infirmière à l’étage, pharmacie, gestion des rendez-vous, prise en charge des images…). Ce processus de mise en place d’un EMR (Electronic Medical Record) sera géré par un seul et même software américain : EPIC.
« Il s’agit là d’un projet colossal mais qui est aujourd’hui tout à fait nécessaire, car il va optimiser notre fonctionnement et sécuriser la prise en charge des patients. Le TPI² va simplifier notre travail dans de nombreux secteurs; tout va être scanné plutôt qu’encodé donc nous allons réduire au maximum le risque d’erreurs, toutes les étapes de la prise en charge d’un patient vont être traquées, tout sera traçable, et beaucoup pourra être anticipé… C’est vraiment un challenge qui m’intéressait. »
Les CUSL, qui sont le premier hôpital francophone dans le monde à adopter EPIC, espèrent servir de modèle pour d’autres hôpitaux francophones en Europe, voire au-delà, et pourraient valoriser aussi une partie du travail de préparation à ce processus, comme la traduction en français, ou encore l’adaptation du programme aux règles spécifiques de la Belgique.
3.Créer du lien, premièrement en interne, avec et entre les membres du département de Pédiatrie et les médecins-assistants candidats spécialistes en pédiatrie (MACCS) et deuxièmement en externe avec les partenaires du réseau hospitalier de l’UCLouvain.
- « Les partenaires du réseau hospitalier se sentent parfois délaissés ou mis en second plan par rapport à un grand hôpital comme le nôtre. Je voudrais changer cette idée et leur permettre de réellement collaborer afin d’aller plus loin ensemble. Ce qui est un vrai challenge, car cela fait des décennies que ça ne va pas forcément dans ce sens-là. Il faut donc les remettre tous nos collaborateurs en confiance et communiquer le plus possible. » Et cette réalité n’est pas seulement vraie pour les partenaires du réseau. « Les assistants en pédiatrie sont victimes du développement d’une médecine compliquée, très administrative… et sont obligés, malgré eux, de jouer le rôle de petites mains, de secrétaires… »
« Étant passé par là, je sais que ces MACCS travaillent de trop nombreuses heures et sont tout le temps sollicités pour prester des gardes le week-end, la nuit… Ce sont pourtant des humains comme les autres qui ont aussi droit à une qualité de vie, une vie de famille, une vie tout court. »
- On l’a compris, le bien-être au travail est l’une des priorités de Stéphane Moniotte ; autant pour ces assistants que pour le personnel en général. Il voudrait par exemple faire en sorte que le « feedback positif » (fait de ne pas souligner uniquement le négatif ou les dysfonctionnements) devienne une habitude. Il est également soucieux de donner la parole à tout le monde et que chacun se sente valorisé dans sa fonction. Et le nouveau chef n’a pas perdu de temps puisque plusieurs initiatives concrètes ont déjà été mises en place, ou sont en cours de concrétisation, dans cette perspective : photo de département intermétier, distribution d’un cadeau symbolique de remerciement en début d’année, discours du nouvel an axé sur le bien-être au travail… et même une course à pied en équipes de deux (un superviseur et un assistant) ; et finalement, la mise en ligne prévue d’une plateforme web d’interaction entre le réseau et le personnel médical et paramédical du département de pédiatrie des CUSL.
Un homme aux multiples facettes
Cette énergie et cette détermination à rendre « le monde » un peu meilleur lui vient certainement de son apparent épanouissement personnel. Deux passions semblent l’animer au quotidien : le sport et la vidéo. « Je cours le Marathon en 2h52; c’est pas rien ! Mais je n’ai pas tellement de mérite, car mon cœur ne bat qu’à 28 pulsations par minute au repos.», explique fièrement le cardiologue. Concernant l’autre corde à son arc qu’est la vidéo, l’homme nous a montré à titre d’exemple un petit film/portrait qu’il a réalisé à Knokke sur sa prédécesseure Christiane Vermylen et qui a été projeté lors de son Éméritat. Il a également réalisé un reportage en trois volets (disponible sur Youtube) intitulé « Naître et Vivre avec une cardiopathie ».
Hôpital 2025, programme de reconstruction des CUSL
Concernant plus généralement les CUSL, un nouveau projet appelé « Hôpital 20-25 » est doucement en train de voir le jour. Il s’agit d’agrandir ou de reconstruire certaines parties de l’hôpital afin de gagner en espace, en modernité et – c’est ce qu’espère le Pr. Moniotte pour son département – en visibilité.
Voilà ce qu’on peut lire sur le web à ce propos : « Le volet le plus spectaculaire du programme ‘Hôpital 2025’ est l’HospitaCité. Il s’agit d’un nouvel ensemble qui comprend la construction d’une nouvelle tour d’hospitalisation et d’accueil du patient (située en face de la tour existante), la rénovation complète du socle médico-technique (comprenant les zones de consultations, le quartier opératoire, le plateau d’endoscopie notamment), la restructuration du noyau logistique (incluant la pharmacie hospitalière ainsi que des espaces techniques et logistiques), la création d’abords végétalisés qui connecteront Saint-Luc au campus de l’UCLouvain et amélioreront la mobilité douce et durable, et la réhabilitation de la tour d’hospitalisation actuelle. Ce programme inclut également la construction de deux autres bâtiments majeurs : l’Institut Roi Albert II qui regroupe les activités de cancérologie et d’hématologie ; l’Institut de psychiatrie rassemblant les activités de psychiatrie pédiatriques et adultes de Saint-Luc et de la Clinique Sanatia (actuellement située à Saint-Josse). »