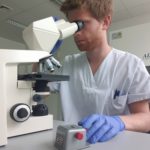Fratriha, association de sensibilisation, de soutien et d’information à destination des fratries de personnes handicapées, vit actuellement un renouveau. Anciennement liée à l’asbl Inclusion, elle a décidé de prendre son indépendance et s’est tout récemment constituée en asbl. Sa présidente et fondatrice, Eleonore Cotman, dont la sœur est porteuse d’un handicap, a accepté de nous parler, d’une part, de l’association et, d’autre part, du ressenti, des attentes ou encore de la condition des fratries. Ceci impliquant leurs relations, parfois teintées d’incompréhensions, avec leur famille, les professionnels et la société.


Ce nouveau départ, après 6 ans au sein d’Inclusion, est synonyme de beaucoup de changements chez Fratriha. D’abord, le personnel va s’étoffer et ensuite, les collaborations, les initiatives et autres projets vont se multiplier. D’ailleurs, dès la rentrée, un nouveau projet pour les fratries de 6 à 10 ans va voir le jour : « Le Baluchon ».
PORTRAIT – Eléonore Cotman, présidente de l’asbl Fratriha et sœur d’une personne avec handicap
-
FratriHa est une activité secondaire puisque vous y êtes bénévole, qu’est-ce qui vous pousse à donner de votre temps au projet ?
C’est vrai que je travaille à temps plein à côté de mon activité à l’asbl et que gérer les deux est assez compliqué. Mais j’aime m’y investir, car c’est un projet que j’ai initié et qui me tient fort à cœur. C’est aussi très valorisant de se dire qu’on peut apporter quelque chose aux familles, ou même aux professionnels qu’on sensibilise.
-
Pourquoi ne pas alors vous y consacrer à 100% ?
J’y ai pensé bien sûr, mais je suis déjà confrontée au handicap dans ma vie personnelle, alors y travailler tout le temps ne serait pas tenable émotionnellement parlant. J’ai aussi peur de perdre le plaisir que j’ai actuellement à faire cela en seconde activité.
-
Aider les autres vous permet-il d’affronter plus sereinement votre réalité ?
Récemment, mon papa m’a dit que d’avoir créé ce projet m’avait en quelque sorte « sauvée ». Je crois en effet que ça m’a fait beaucoup de bien pour plusieurs raisons. Avant tout parce que ça m’a permis de dire des choses sur lesquelles je n’avais jamais pu mettre de mots ; car c’est assez dur d’en parler, surtout avec sa propre famille. D’où l’idée de créer des groupes de paroles pour que chacun puisse exprimer ce qu’il a sur le cœur et le partager avec d’autres fratries dans la même situation.
1. Parlez-nous du projet FratriHa ; quand et comment est-il né ?
Il y a 6 ans de cela, Elise Petit et moi-même avons eu l’idée de créer Fratriha en réponse à un constat alarmant : rien n’existait pour les frères et sœurs de personnes avec un handicap. Nous sommes toutes deux concernées et il nous paraissait donc logique de lancer un projet de ce type. Et il a très vite fonctionné ; la preuve qu’il y avait une réelle demande.
2. En quoi consiste-t-il ?
Ce projet s’articule en trois pôles :
- L’information
On fournit de l’information autour des fratries de personnes en situation de handicap. Cela passe par des conférences, qu’on essaie d’organiser deux fois par an sur des thèmes variés (« Le regard des autres sur le handicap », «L’après-parents »…), des participations à des colloques, des formations et, bien sûr, il est possible de s’informer directement sur notre site web.
- La sensibilisation
Le but est de parvenir à sensibiliser les professionnels, les parents et la société à la thématique de la fratrie.
« Car les frères et sœurs sont souvent les enfants de l’ombre alors que l’enfant avec un handicap est plutôt dans la lumière. Notre objectif est de répartir la lumière sur tous les enfants d’une même famille. »
Concrètement, nous nous déplaçons (soit Elise et moi, soit d’autres frères et sœurs actifs au sein de l’association) pour raconter notre vécu via ce qu’on appelle des « témoignages ». Nous abordons quatre thématiques rencontrées par la plupart des fratries (le regard extérieur, la culpabilité, les responsabilités et les aspects positifs) afin de donner une idée plus précise de ce que nous vivons. À travers ce rôle de sensibilisation, nous avons donc aussi la casquette de porte-parole, notamment quand il s’agit de s’adresser aux politiques.
- Le soutien aux fratries
Des activités « ordinaires entre fratries extraordinaires » sont régulièrement organisées. Nous nous sommes par exemple rendus à Pairi Daiza, à la mer du Nord… Il y a aussi des groupes de paroles entre frères et sœurs soit très jeunes, soit adolescents, soit adultes. Une psychologue est également disponible pour les familles lors de ces rencontres.
3. Comment se compose l’équipe de Fratriha ?

Depuis la création de Fratriha, nous dépendions de l’asbl Inclusion. Mais depuis le 1er juillet, nous avons pris notre indépendance et sommes à présent constitué en asbl. Ce changement important impliquera forcément un élargissement de l’équipe. Je suis la présidente de l’asbl et Elise est la vice-présidente. Un chargé de projet va bientôt être engagé à mi-temps et nous faisons régulièrement appel à une psychologue indépendante, ainsi qu’à une graphiste pour des prestations occasionnelles.
4. Qu’est-ce qu’on ressent quand on est frère/sœur d’une personne handicapée ?
D’abord, le ressenti d’un frère ou d’une sœur est différent selon la place qu’il/elle a dans la fratrie. Par exemple, Elise a deux grands frères, l’un avec un handicap et l’autre pas, et un petit frère aussi avec handicap ; elle dit que sa relation avec le plus grand a toujours été plus conflictuelle (car elle l’a un jour dépassé en autonomie) qu’avec le plus petit, avec qui elle a un rôle beaucoup plus maternel.
« Ensuite, la plupart essaie de ne pas faire trop de vagues, de ne pas causer plus de soucis à leurs parents ; ils les aide et tentent d’être utile et responsable en prenant beaucoup sur leurs épaules. Ce qui génère forcément de la pression. »
Et puis enfin, il est clair que les frères/sœurs ont tendance à minimiser leur souffrance puisqu’ils estiment qu’elle est moins légitime que celle de leur frère/sœur avec un handicap. Ils se mettent volontairement dans l’ombre et incitent presque leurs proches à faire de même avec eux.
5. Comment se concrétise l’aide aux fratries de personnes déficientes intellectuelles ?
Comme je l’ai dit, on soutient les fratries de diverses manières ; on leur propose de participer à des activités ludiques, on organise des groupes de parole et on relaie les fratries vers le réseau en cas demandes particulières.

Le Baluchon
Il y a également un nouveau projet qui va être lancé à la rentrée scolaire, qui s’appelle « Le Baluchon » et qui s’adresse aux très jeunes fratries (6-10 ans). Le principe ? Un petit sac en coton avec plein de chouette choses à l’intérieur : trois livres qui parlent du handicap, dont un plus personnalisé selon le type de handicap du frère ou de la sœur de l’enfant, un coloriage géant avec plein de petites scénettes évoquant des situations généralement vécues par les fratries, et enfin, un petit livret explicatif destiné aux parents. Le but de ces outils est surtout de débloquer la parole et d’éveiller les émotions chez ces enfants qui ont souvent bien du mal à trouver leur place.
6. De quoi les fratries ont-elles le plus besoin au moment où elles viennent vous voir ?

Justement, de parler et de partager leur vécu avec d’autres. Pour les jeunes fratries, ce sont les parents qui nous contactent, surtout pour savoir comment et quand aborder le handicap en famille. Les adolescents, eux, se posent plus la question de leurs responsabilités éventuelles, de comment ils devront faire quand leurs parents ne seront plus là pour s’occuper du frère ou de la sœur avec handicap. Ils se préoccupent aussi beaucoup du regard des autres sur le handicap de leur proche ; notamment sur les réseaux sociaux. Et enfin, les fratries adultes se demandent plutôt comment vivre leur vie de couple ou de famille en intégrant leur frère/sœur, comment s’organiser une fois que les parents sont plus là, et aussi, la place qu’ils ont en tant que fratrie au sein des institutions.
7. En parlant d’institutions, les professionnels s’intéressent-ils suffisamment aux fratries ?
C’est en progression, mais ce n’est pas encore assez généralisé. Les fratries sont souvent mises au second plan et ne reçoivent pas souvent d’explications de la part des médecins ou du personnel soignant. Pour ma part, je me souviens que les passages obligés dans les hôpitaux ont été extrêmement marquants et traumatisants. On est là, on voit tout, on entend tout et personne ne prend la peine de nous rassurer à part nos parents, qui eux-mêmes sont submergés par les émotions. Dans les institutions plus spécialisées, c’est pareil ; si ces dernières organisent quelque chose (une journée pour les familles par exemple) les parents sont toujours prévenus, mais jamais les fratries.
« Il faut que les professionnels prennent davantage conscience de l’importance de les prendre en compte. D’où l’importance de me déplacer pour tenter de les sensibiliser. »
8. Dans certains hôpitaux, des espaces sont justement consacrées aux fratries ; je pense au groupe Fratrie de l’Huderf ou aux ateliers Arcadie aux Cliniques universitaires Saint-Luc.
Oui, et heureusement qu’il existe ce genre d’initiatives, mais cela reste encore anecdotique et ponctuel. Ces dernières doivent certainement se multiplier, car l’hôpital est un moment charnière dans la vie d’un frère ou d’une sœur ; c’est très dur psychologiquement et parfois traumatisant. Avoir un espace de parole à ce moment-là est donc très important et permet aussi d’accrocher les fratries pour qu’elles continuent à se livrer et à fréquenter des endroits comme celui que nous proposons.
9. Les parents, quant à eux, prennent-ils tout de suite conscience que leurs autres enfants ont eux aussi besoin d’être soutenus ?
Cela dépend très fort. Parfois, les fratries ne montrent pas forcément de signes de mal-être ou de souffrance, donc les parents ne se doutent pas du malaise qu’il peut y avoir. C’est pour cela que, par le biais de notre volet « sensibilisation aux parents », nous tentons de donner des clés pour déceler plus facilement ces signes.
« Ce qui est sûr, c’est que les parents qui viennent chez nous sont souvent très démunis et ne savent pas comment aborder le handicap avec la fratrie. »
10. Y-a-t ’il un réel manque de conscientisation de la thématique du handicap et des fratries au sein de la société ?
Clairement oui. Concernant la thématique du handicap en général, les gens disent souvent « les handicapés » au lieu de dire « les personnes handicapées » ; comme si elles n’étaient pas des personnes et qu’elles se définissaient uniquement pas leur handicap.
« Et ces insultes très courantes du style « espèce d’handic » ou « sale triso », ça me met hors de moi parce que ça stigmatise énormément. Ça implique que certaines fratries n’osent pas avouer le handicap de leur frère/sœur. »
Mais ça va quand même mieux qu’avant ; depuis qu’il y a des émissions comme Cap48 par exemple, on sent que les regards changent un peu. Fratriha tente également de sensibiliser le grand public en participant notamment aux 20km de Bruxelles ou, projet futur, en organisant une exposition de photos.
11. Êtes-vous en collaboration avec d’autres associations ?
Oui bien sûr, c’est très important de collaborer. Par exemple, avec Jeunes Aidants Proches avec qui on a plusieurs projets en commun ; on les invite à nos formations et eux à leurs colloques. On collabore aussi avec la Casa Clara ou la Villa Indigo, qui sont des maisons de répit. Toutes les associations liées à Inclusion, comme Madrass, la Fondation Portray… font évidemment partie de notre réseau proche. On se fait souvent inviter aussi dans des écoles ou des centres de jour (ex : Horizon 9, Notre Village, Le Centre Roi Baudouin…)
12. Qu’est-ce qui est prévu pour la suite ? Des événements en préparation ?
À très court terme il y a donc la prise de notre indépendance et la constitution de Fratriha en asbl, il faut engager le/la chargé.e de projet à Bruxelles et enfin nous lancerons le projet « Baluchon » dans très peu de temps.
Á long terme, ce serait pas mal d’engager un.e chargé.e de projet pour la Wallonie et un.e psychologue à plein temps. On aimerait aussi organiser des stages pour les jeunes fratries, créer des événements de sensibilisation pour le grand public comme l’expo photos déjà évoquée…







 Le deuxième ingrédient des Octofun, c’est la gestion mentale (une théorie avancée par Antoine de La Garanderie, un pédagogue français). L’idée est d’apprendre à gérer son cerveau pour mieux l’utiliser; d’enseigner aux élèves les processus cognitifs pour acquérir le savoir et les rendre acteurs de leur apprentissage.
Le deuxième ingrédient des Octofun, c’est la gestion mentale (une théorie avancée par Antoine de La Garanderie, un pédagogue français). L’idée est d’apprendre à gérer son cerveau pour mieux l’utiliser; d’enseigner aux élèves les processus cognitifs pour acquérir le savoir et les rendre acteurs de leur apprentissage.