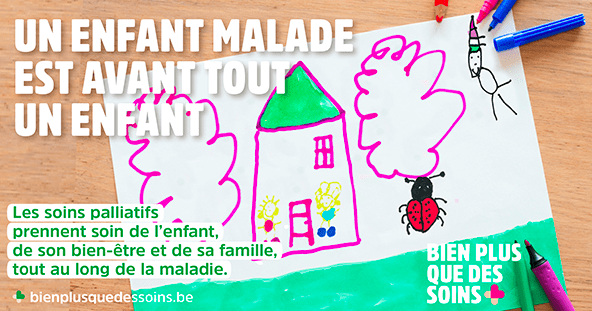La Ligue des familles a dévoilé ce 16 décembre les résultats de son cinquième baromètre des parents. Il s’est focalisé cette année sur la santé des familles et, plus particulièrement, sur les maladies graves d’un membre de la famille, sur le paiement des factures d’hôpital et sur le report de soins à prodiguer aux enfants pour raisons financières. Un constat flagrant en ressort : « soigner coûte cher, bien trop cher encore ».

Ce baromètre des parents 2020 a donc consacré un « focus » aux questions de santé dans la famille. « Partout, le même implacable constat, relève Christophe Cocu : nous sommes dans un des pays les mieux lotis au monde à cet égard, il n’empêche que se soigner coûte cher, bien trop cher encore. Dans les familles les plus pauvres mais aussi dans les plus privilégiées, un problème de santé, et tout le ménage peut basculer dans les difficultés financières. »
Des difficultés financières pour 2/3 des familles en cas de grave maladie d’un enfant
Il ressort ainsi que pas moins de la moitié des familles (48%) confrontées à une grave maladie d’un des parents (ou d’un autre adulte vivant dans le ménage) rencontrent des difficultés financières, et près de 2/3 (63%) de celles confrontées à une grave maladie d’un enfant. Les parents concernés auraient voulu en priorité davantage de congés pour s’occuper de leur enfant gravement malade (48%). Ils auraient également voulu un soutien financier (46%) et des soins de santé moins chers (35%).
La Ligue a notamment demandé aux familles si elles avaient dû reporter des soins à un enfant pour des raisons financières. Cela a été le cas pour 22% d’entre elles. Pour certaines familles, ce pourcentage est même plus élevé puisque 34% des familles nombreuses se sont déjà retrouvées dans cette situation. C’est également le cas de 28% des familles monoparentales et des familles recomposées, contre 17% des familles « classiques ».
1 parent sur 4 à déjà eu des difficultés à payer une facture d’hôpital pour son enfant
Le baromètre indique également que 26% des parents déclarent avoir déjà eu des difficultés à payer les factures d’hôpital de leurs enfants. C’est encore une fois particulièrement difficile pour familles monoparentales qui sont 36% à avoir vécu cette situation contre 28% des familles recomposées et 21% des parents en couple avec le père/la mère de leurs enfants. Les familles nombreuses (36%) ont également indiqué avoir davantage vécu cette situation que les familles d’un (23%) ou de deux enfants (26%).
Logiquement, moins les familles sont aisées, plus elles sont nombreuses à avoir déjà éprouvé des difficultés à honorer une facture d’hôpital. Cela a été le cas pour 47% des familles ayant des revenus mensuels inférieurs à 1500 euros, 32% des familles ayant des revenus entre 1500 et 2999 euros, 21% des familles ayant des revenus compris entre 3000 et 4999 euros et 9% des familles ayant des revenus égaux ou supérieurs à 5000 euros. Il est frappant de constater que dans toutes les catégories de revenus, y compris les plus élevées, les factures d’hôpital ont mis une partie non négligeable des familles en difficulté financière.