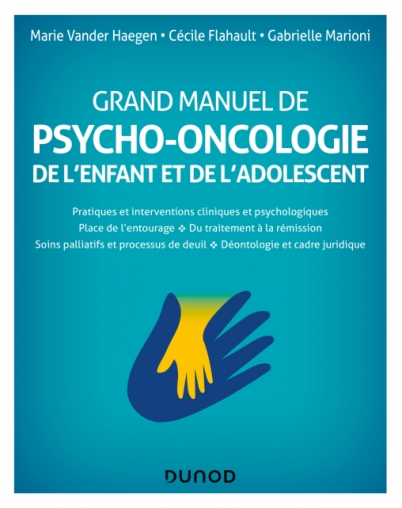Le 13 novembre 2023, le comité d’assurance de l’INAMI a donné son feu vert à la coopération avec six hôpitaux qui offriront des soins adaptés à l’âge pour les jeunes atteints d’un cancer (AJA). À partir du 1er décembre 2023, ces hôpitaux de référence seront rémunérés pour leurs équipes de référence spécifiques AJA. Le coup d’envoi de la nouvelle convention est le fruit d’une collaboration entre Frank Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Kom op tegen Kanker, le personnel de l’INAMI et une poignée d’AJA enthousiastes.

Dans un communiqué, le ministre précise le bien fondé de cette nouvelle convention : « Le cancer chez les jeunes est très difficile à accepter, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Les autorités doivent donc faire tout ce qui est en leur pouvoir pour fournir des soins et une aide sur mesure. Comment ? Nous allons offrir aux adolescents et aux jeunes adultes atteints d’un cancer des soins de qualité et adaptés à leur âge, afin d’améliorer leur qualité de vie pendant et après le traitement. En plus de leurs interrogations sur leur rétablissement physique, les jeunes à qui un cancer est diagnostiqué se posent des questions sur leur avenir, qu’il s’agisse d’emploi, d’école ou de projet d’enfant. »
1.700 diagnostics par an
Le cancer chez les adolescents et les jeunes adultes entre 16 et 35 ans est assez exceptionnel. En Belgique, il s’agit d’environ 1.700 diagnostics par an. Ces jeunes, adolescents et jeunes adultes, ou « AJA » en abrégé, sont souvent vulnérables. Ils ont des besoins de soins uniques qui diffèrent de ceux des enfants, mais aussi de ceux des adultes plus âgés. Les AJA ont souvent des problèmes médicaux spécifiques et sont confrontés à de nombreux défis sur le plan psychosocial. C’est pourquoi ils méritent des soins et un suivi sur mesure. « Les AJA sont en phase de développement psychologique et physique et ont beaucoup d’autres préoccupations : qu’en est-il de l’école ou des études qui sont interrompues, comment combiner un traitement avec son emploi, qu’en est-il de la fertilité et du souhait d’avoir des enfants ? Soudain, tous les aspects de la vie d’un adolescent ou d’un jeune adulte atteint d’un cancer sont mis en suspens à un moment où ils aspirent à l’autonomie », explique Frank Vandenbroucke.
Six hôpitaux signent la convention
Six hôpitaux belges concluront une convention avec l’INAMI à partir du 1er décembre 2023. Parmi les six hôpitaux, deux sont bruxellois : l’Institut Jules Bordet et les Cliniques universitaires Saint-Luc. Pour offrir ces soins spécialisés, adaptés à l’âge et cette aide sur mesure aux adolescents et aux jeunes adultes atteints d’un cancer, il faut disposer d’une certaine expertise. Les équipes de référence AJA des six hôpitaux serviront de source centrale de connaissances et d’expérience. Ces équipes apporteront leur expertise et leur soutien – au plan médical comme au plan psychosocial – aux équipes de soins et de traitement dans leur propre établissement, mais aussi dans d’autres hôpitaux et dans le cadre des soins primaires. Un budget de démarrage de 600.000 euros sera alloué cette année encore. À partir de 2024, 1,2 millions d’euros seront débloqués annuellement pour les conventions avec les différents hôpitaux.
Un an pour développer ou renforcer leur expertise interne en matière d’AJA
L’objectif à long terme est de développer et de mettre en œuvre une politique de soins AJA harmonisée. À cette fin, les différentes équipes AJA collaborent au sein d’un groupe de projet pour la recherche scientifique, le développement, la mise en œuvre et l’évaluation de nouvelles évolutions dans le domaine de ces soins spécifiques. Cette convention INAMI donne aux hôpitaux un an pour développer ou renforcer leur expertise interne en matière d’AJA. Dès que l’équipe de référence AJA aura acquis suffisamment d’expertise, elle se verra également confier une mission d’outreaching auprès d’autres hôpitaux et prestataires de soins primaires. Concrètement, les équipes de référence AJA dans les hôpitaux devront être opérationnelles à partir du 1er janvier 2024. À partir du 1er janvier 2026, la fonction d’avis doit être étendue à d’autres hôpitaux.
Cinq priorités dans les soins AJA de qualité
Les six hôpitaux qui participent à la convention INAMI souscrivent à cinq priorités en matière de soins AJA :
- Un diagnostic précoce
- Une orientation précoce vers la médecine de la reproduction
- Des tests génétiques précoces
- Des études cliniques
- Un soutien psychosocial
À LIRE AUSSI :
- Cancers pédiatriques : plusieurs avancées importantes en approche
- Cancer pédiatrique : parution du Grand manuel de psycho-oncologie pour accompagner les acteurs concernés
- Run to Kick : une course solidaire contre les cancers pédiatriques
- Recherche sur le cancer : des financeurs belges unissent leurs forces
- Childrencancer.be : pour un accès facilité aux données d’asbl actives en oncologie pédiatrique