Une technologie développée pour surveiller la santé cardiaque des astronautes pourrait bientôt révolutionner le dépistage des malformations cardiaques congénitales chez les enfants. Testée à l’Hôpital Erasme et à l’Hôpital Universitaire des enfants Reine Fabiola, cette innovation repose sur la sismocardiographie, une méthode non invasive qui analyse les vibrations du cœur.

Initialement conçue pour étudier l’impact de la microgravité sur le système cardiovasculaire des astronautes, une technologie développée par le laboratoire de physique et de physiologie (LPHYS) de l’Université libre de Bruxelles (ULB) trouve une nouvelle utilité sur la terre ferme. Enregistrant avec précision les vibrations du cœur, elle pourrait permettre un dépistage précoce des malformations cardiaques congénitales chez les enfants. Actuellement en phase d’essai clinique, cette méthode prometteuse illustre comment la recherche spatiale peut contribuer directement aux avancées médicales.
{ Communiqué de presse du SPP Politique scientifique (BELSPO) }
Surveiller la santé cardiaque et vasculaire
Une recherche initialement destinée aux astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) trouve aujourd’hui une application sur Terre. Le Laboratoire de physique et de physiologie (LPHYS) de l’Université libre de Bruxelles (ULB), en collaboration avec l’Hôpital Erasme, a développé une technique conçue à l’origine pour surveiller la santé cardiaque et vasculaire des astronautes. Cette technologie est désormais testée pour détecter les malformations cardiaques congénitales chez les enfants.
Dans le cadre d’une recherche financée par BELSPO (SPP Politique scientifique), l’équipe du LPHYS a étudié l’état physique des astronautes dans l’espace, et plus précisément l’impact de la microgravité sur le cœur. « Dans l’espace, le corps humain se transforme : en quelques semaines, sans contremesures adéquates, le cœur d’un astronaute peut rétrécir comme celui d’un patient alité pendant des mois sur Terre. Sans gravité pour le stimuler, ce muscle vital s’affaiblit, mettant en péril l’endurance et la capacité d’adaptation des astronautes. Surveiller leur fonction cardiovasculaire n’est pas une option, c’est une nécessité. », explique expliquent professeur Vitalie Faora en docteur Amin Hossein de l’ULB.
Sauver des vies d’enfants
L’équipe a mis au point une méthode permettant de surveiller l’état du cœur et des vaisseaux sanguins grâce à la sismocardiographie, une technique qui enregistre les vibrations cardiaques au niveau du thorax. Ces signaux permettent d’analyser avec précision, les phases, la force et l’énergie des battements du cœur afin d’assurer un suivi de l’état physique des astronautes et d’étudier les effets de l’apesanteur sur leur système cardiovasculaire.
Aujourd’hui, cette technologie trouve une nouvelle application dans un domaine tout aussi essentiel : le dépistage précoce des malformations cardiaques chez les jeunes patients. « C’est un bel exemple de la manière dont la recherche spatiale peut contribuer à des avancées médicales concrètes sur Terre », souligne Arnaud Vajda, président du comité de direction de BELSPO. « Cette technologie constitue une méthode non invasive et à moindre coût pour détecter précocement des pathologies cardiaques congénitales et, potentiellement, sauver des vies d’enfants. »
L’équipe du LPHYS a lancé un essai clinique à l’Hôpital Erasme et à l’Hôpital Universitaire des enfants Reine Fabiola afin de poursuivre l’évaluation de cette technologie.
À propos de Belspo
Avec plus de 2 500 collaborateurs, le SPP Politique scientifique, ou BELSPO (pour « Belgian Science Policy Office »), n’est pas une institution comme les autres. Il est l’acteur central de la politique scientifique en Belgique. Avec quatre directions et dix établissements scientifiques fédéraux reconnus, leur mission est de stimuler la recherche scientifique et l’innovation dans tous les domaines, pour bâtir un avenir meilleur pour la Belgique. Les domaines de BELSPO sont variés, allant de la recherche et des applications spatiales, au financement de programmes de recherche scientifique, en passant par la mise en réseau des chercheurs nationaux et internationaux, l’étude du climat, ou le financement des musées royaux.
Partagé par Sofia Douieb
À LIRE AUSSI :
-
Avancées prometteuses pour apaiser les troubles cognitifs liés à la trisomie 21
-
Handicap visuel : retour sur un projet de casque d’escalade Bluetooth
-
« Solem » : nouveau dispositif inclusif de soutien au langage dès la maternelle !
-
Les soins pédiatriques à domicile en passe d’être révolutionnés par la technologie





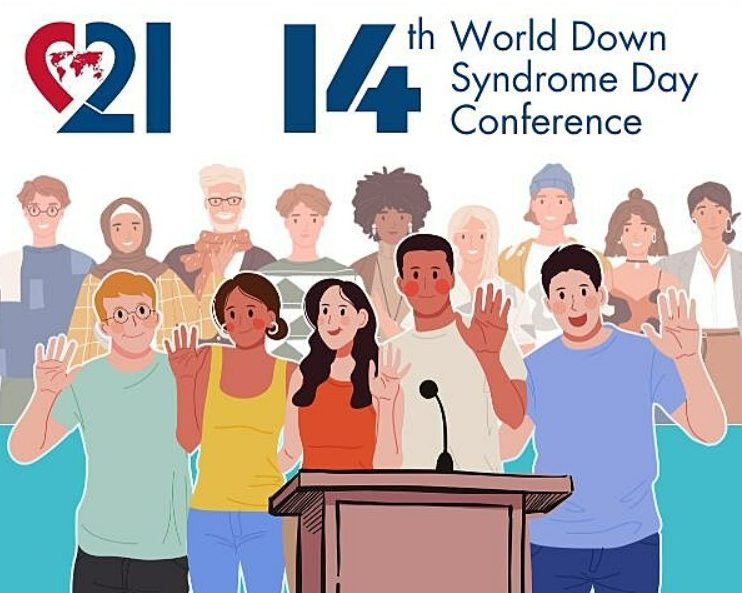 Pour soutenir la cause, une invitation a été lancée sur la site de Si, un réseau qui comprend plus de 150 organisations internationales qui représentent et soutiennent la communauté trisomique dans leur pays. Et cette année, à l’occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, des événements sont proposés sur plusieurs jours aux Nations Unies à Genève. « Les personnes atteintes du syndrome de Down ont besoin d’aide pour vivre et être intégrées dans la communauté, comme tout le monde. Les familles ont également besoin de soutien, car elles soutiennent souvent le membre de leur famille atteint du syndrome de Down. Le soutien est un droit de l’homme essentiel qui contribue à rendre les autres droits possibles. Le soutien dont nous avons besoin est différent pour chaque personne. Nous avons le droit de bénéficier d’un soutien qui répond à nos besoins et nous donne le choix, le contrôle et la dignité », peut-on encore lire sur leur site.
Pour soutenir la cause, une invitation a été lancée sur la site de Si, un réseau qui comprend plus de 150 organisations internationales qui représentent et soutiennent la communauté trisomique dans leur pays. Et cette année, à l’occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, des événements sont proposés sur plusieurs jours aux Nations Unies à Genève. « Les personnes atteintes du syndrome de Down ont besoin d’aide pour vivre et être intégrées dans la communauté, comme tout le monde. Les familles ont également besoin de soutien, car elles soutiennent souvent le membre de leur famille atteint du syndrome de Down. Le soutien est un droit de l’homme essentiel qui contribue à rendre les autres droits possibles. Le soutien dont nous avons besoin est différent pour chaque personne. Nous avons le droit de bénéficier d’un soutien qui répond à nos besoins et nous donne le choix, le contrôle et la dignité », peut-on encore lire sur leur site.
