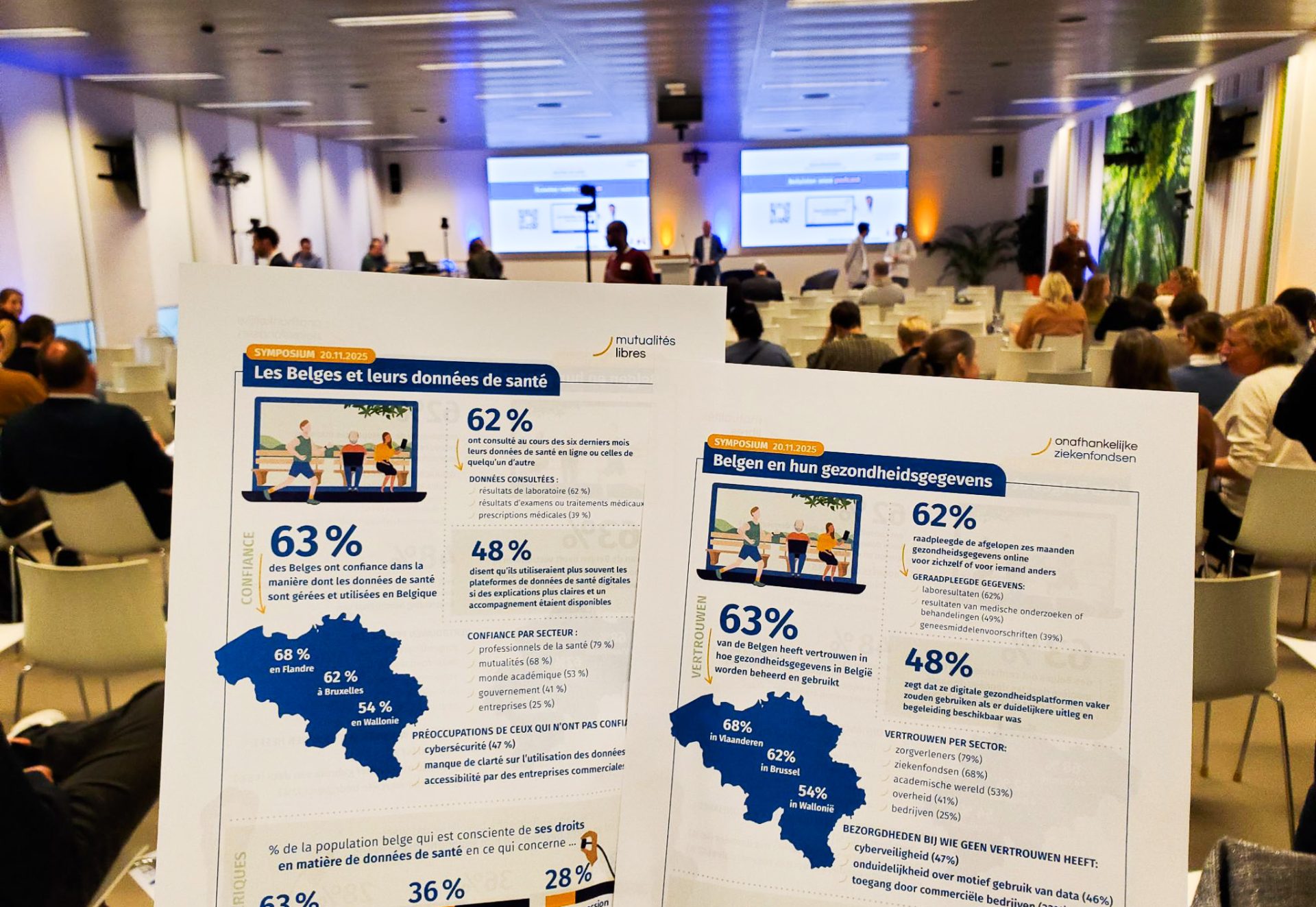L’année 2025 a été riche en rencontres et en découvertes pour l’équipe d’Hospichild. De nombreux articles (près d’une centaine), autant en français qu’en néerlandais, ont permis de mettre en valeur de nouveaux projets et pléthore d’infos inédites autour du secteur pédiatrique bruxellois. Florilège de ceux qui ont été les plus consultés, partagés ou commentés sur notre site ou via nos réseaux sociaux.

Pour rappel, Hospichild est un site d’infos et de ressources autour de l’enfant hospitalisé, malade ou handicapé, en Région bruxelloise. En plus du contenu permanent, revu et corrigé quotidiennement, nous publions des articles d’actualité, des reportages, des interviews… Et ce, plusieurs fois par semaine, depuis plus de 19 ans. Parmi les articles de 2025, certains sortent quelque peu du lot et ont davantage attiré l’attention de nos lecteurs. Petit récapitulatif (du plus récent au plus ancien de l’année 2025).
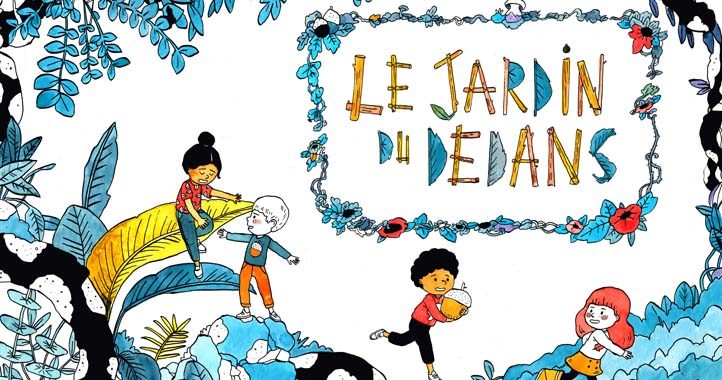
« Le Jardin du Dedans » : un nouveau podcast pour parler santé mentale aux jeunes
Créé par Psycom – organisme public d’information sur la santé mentale en France – « Le Jardin du Dedans » propose un podcast à destination des enfants âgés de 8 à 11 ans. Il s’agit initialement d’un outil pédagogique qui offre désormais une écoute podcast composée de 10 épisodes ainsi que d’un clip vidéo. Le deuxième épisode vient de sortir le 13 décembre 2025.
→ Écouter les premiers épisodes du podcast
Handicaps invisibles : le tournesol comme symbole international d’inclusion dans certains lieux publics
En Belgique, 660 000 personnes sont en situation de handicap. Parmi elles, 80% vivent avec un handicap invisible – difficultés d’apprentissage, douleurs chroniques, autisme, problèmes de santé mentale… – qui impacte leur quotidien mais qui n’est pas forcément reconnu. C’est souvent dans des situations de vie que le problème se pose. Pas de privilèges mais juste un besoin d’assistance, de bienveillance, d’un peu de temps et de patience. C’est en ce sens que le tournesol a été associé à la cause : un symbole, un badge, une carte ou un pin’s, qui signale aux autres, dans certains lieux publics, que l’on est porteur d’un handicap invisible, sans même devoir le dire.
→ En découvrir davantage sur ce symbole
La santé mentale monte sur scène : un peu de poésie pour panser les plaies
 Lors d’une soirée poésie organisée par La Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale (LBSM), plusieurs artistes sont montés sur scène pour y déverser leur trop plein d’émotions ou pour rendre hommage au secteur de la santé mentale. C’était le 16 octobre dernier et une des membres de l’équipe d’Hospichild a voulu participer à la scène ouverte. Elle a écrit un texte pour l’occasion et l’a clamé devant les spectateurs. Notre pierre à l’édifice pour que les gens qui ne vont pas bien soient enfin vus et entendus.
Lors d’une soirée poésie organisée par La Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale (LBSM), plusieurs artistes sont montés sur scène pour y déverser leur trop plein d’émotions ou pour rendre hommage au secteur de la santé mentale. C’était le 16 octobre dernier et une des membres de l’équipe d’Hospichild a voulu participer à la scène ouverte. Elle a écrit un texte pour l’occasion et l’a clamé devant les spectateurs. Notre pierre à l’édifice pour que les gens qui ne vont pas bien soient enfin vus et entendus.
→ Lire le slam écrit par l’une de nos collègues
Thérapie canine : l’Hôpital des Enfants franchit le pas
L’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) vient de l’annoncer : un petit chien nommé Tika a rejoint l’unité des soins intensifs. Cette initiative innovante, soutenue par Kids Care, vise à améliorer le bien-être des jeunes patients et de leurs parents grâce à la thérapie assistée par l’animal.
→ Découvrir les bienfaits de la thérapie canine
Quand les films d’animation ouvrent les yeux sur le handicap 
Trois films d’animation sortis ces derniers mois placent des enfants en situation de handicap au cœur de leur récit : Le Monde de Wishy, actuellement en salle, Buffalo Kids et Hola Frida, tous deux sortis cet été. Un pas de plus vers l’inclusion et la représentation de la différence à l’écran, pour sensibiliser dès le plus jeune âge. Qu’ils prennent la forme d’une aventure fantastique, d’un western familial ou d’une biographie, ces films participent à un même mouvement : intégrer le handicap dans les récits pour enfants, non pas comme un fardeau, mais comme une part de la vie.
→ En savoir plus sur ces films d’utilité publique
Des trajets de soins remboursés pour aider les jeunes dans leurs troubles alimentaires
Selon Sciensano – centre de recherche qui est l’institut national de santé publique en Belgique – 7 % des adolescent.e.s sont en situation d’obésité. 12 % des 10-17 ans, dont les filles sont deux fois plus touchées que les garçons, présentent une suspicion de troubles du comportement alimentaire. Pour rééquilibrer la balance, l’INAMI a mis en place un système de soins intégrés et multidisciplinaires. L’objectif ? Aider les jeunes à (re)trouver un équilibre alimentaire et à devenir acteur.rice.s de leur propre santé.
→ Plus de détails sur ces nouveaux trajets de soins
 Découverte littéraire : « Blessures » indicibles suite à la perte d’un frère ou une sœur
Découverte littéraire : « Blessures » indicibles suite à la perte d’un frère ou une sœur
« Blessures » est un ouvrage poignant écrit par François-Xavier Perthuis et publié chez l’Harmattan, qui explore la douleur indicible de la perte d’un frère ou d’une sœur. Ce récit, à la fois intime et universel, invite à une réflexion sur le deuil, la mémoire et la reconstruction. Chez Hospichild, la fratrie d’un enfant gravement malade ou handicapé nous préoccupe tout particulièrement, et ce depuis de nombreuses années. Quand il est question d’un deuil, c’est d’autant plus compliqué pour les familles de surmonter leur chagrin et de continuer à laisser une place au frère ou la sœur qui doit continuer à vivre avec cette terrible absence.
→ Découvrir cette histoire poignante
HandyPark : la nouvelle application qui simplifie la mobilité des personnes en situation de handicap
La Direction générale Personnes handicapées (SPF Sécurité sociale) a partagé la nouvelle sur sa page : l’application HandyPark est dorénavant disponible. Son objectif ? Faciliter le stationnement en permettant aux personnes reconnues en situation de handicap d’associer numériquement leur carte de stationnement à leur plaque d’immatriculation. Ainsi, leur droit de stationnement est automatiquement reconnu par les systèmes numériques des villes concernées ; ce qui évite les éventuels tracas.
→ Télécharger l’appli HandyPark
Soins palliatifs pédiatriques (SPP) : la Fondation Roi Baudouin partage ses recommandations 
Les soins palliatifs constituent l’un des sujets les plus préoccupants pour la Fondation Roi Baudouin. À cet égard, elle vient de publier un rapport intitulé « Une esquisse de la situation pour identifier les priorités », réalisé en concertation avec le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) et le Centre du cancer de Sciensano. On y trouve notamment un état des lieux et des recommandations, dont cinq priorités en vue d’améliorer l’accès et la qualité des soins palliatifs pédiatriques (SPP) des enfants et des adolescents en Belgique.
→ Lire le rapport de la FRB
Tous ensemble pour « Vaincre la méningite d’ici 2030 »
Chaque année, la Journée mondiale de lutte contre la méningite, organisée le 24 avril, vise à sensibiliser le public aux dangers de cette maladie et aux moyens de s’en protéger. En Belgique, cet événement permet de rappeler aux familles l’importance de la prévention et du dépistage précoce.
→ Il est urgent d’agir !
 Handicap.brussels : près de 500 vidéos en langue des signes
Handicap.brussels : près de 500 vidéos en langue des signes
Le site handicap.brussels est désormais entièrement accessible aux personnes sourdes et malentendantes : près de 500 capsules vidéos en langue des signes belge francophone (LSFB) sont disponibles. Elles sont activables dans chaque page du site et sont en lien direct avec le contenu écrit. Les interprétations en langue des signes ont été réalisées par des interprètes professionnels sourds, garantissant ainsi une qualité optimale des interprétations.
→ Vers handicap.brussels
Cancers pédiatriques : focus sur les actions de KickCancer pour soutenir la recherche
L’un des principaux acteurs belges apportant un soutien important à la recherche contre le cancer pédiatrique tout au long de l’année, c’est KickCancer. Voici une liste non exhaustive des actions auxquelles vous pouvez participer pour contribuer aux différentes récoltes de fonds.
→ Les actions de KickCancer 
Des poupées en pédiatrie, mais pour quoi faire ?
Juste avant les vacances, l’Hôpital des Enfants mettait en lumière un de ses multiples moyens d’apaiser les enfants hospitalisés : des poupées pédagogiques appelées Kiwanis. Cet outil innovant a fait son apparition dans le service des soins intensifs pour rendre les procédures médicales plus accessibles et moins intimidantes pour les jeunes patients.
→ En savoir plus sur cette méthode d’apaisement
L’équipe d’Hospichild, Emmanuelle, Sofia et Samuel




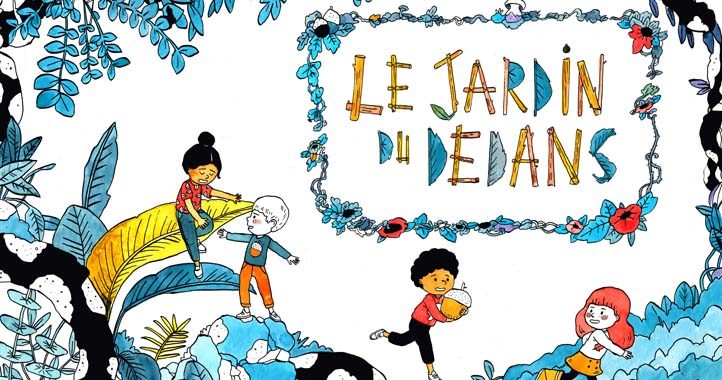


 Découverte littéraire : « Blessures » indicibles suite à la perte d’un frère ou une sœur
Découverte littéraire : « Blessures » indicibles suite à la perte d’un frère ou une sœur
 Handicap.brussels : près de 500 vidéos en langue des signes
Handicap.brussels : près de 500 vidéos en langue des signes

 Health Impact Coalition en chiffres :
Health Impact Coalition en chiffres :