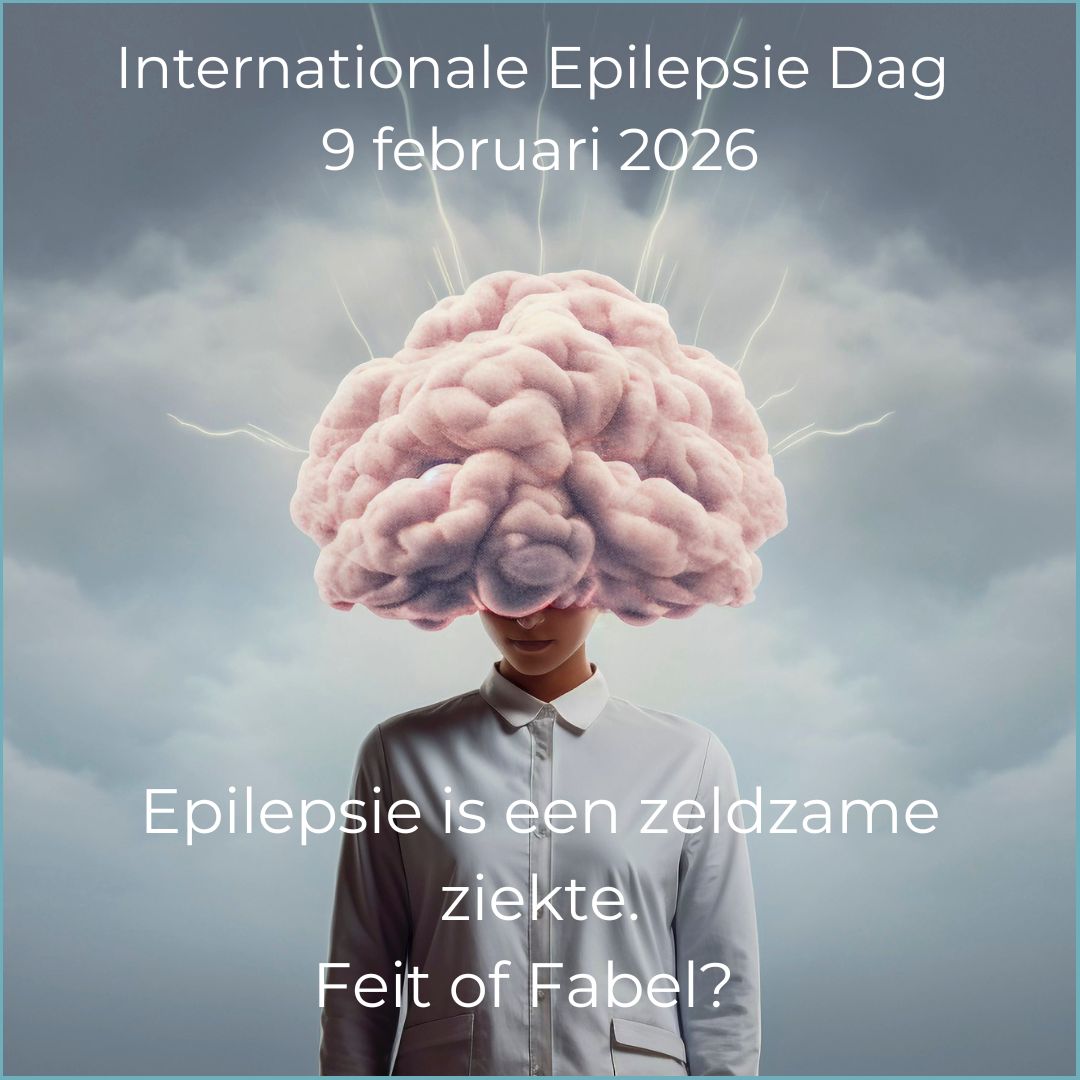Le 15 février, c’est la Journée Mondiale du Cancer de l’Enfant. Pour l’occasion, KickCancer publie les résultats d’une étude réalisée, en collaboration avec la Société Belge d’Hémato-Oncologie Pédiatrique (BSPHO), auprès des hémato-oncologues pédiatres belges. Celle-ci pose la problématique suivante : « Pour sauver la vie des enfants atteints d’un cancer, il faut compter sur le temps libre des médecins ». Une situation qui semble très peu confortable. Elle nécessite en effet d’augmenter le nombre de pédiatres spécialisés, de dégager plus du temps ou encore d’offrir du soutien structurel aux équipes. Coup d’œil sur les points essentiels de l’étude.

{Communiqué de presse de Kick Cancer}
Cette étude met à nu une réalité dérangeante : l’accès aux soins derniers cris dépend structurellement de la bonne volonté des médecins. Plus de 80 % des oncologues pédiatres doivent effectuer leur travail de recherche en dehors de leur temps de travail (42 % y consacre 2 à 5 heures, 29 % 5 à 10 heures, 14 % jusqu’à plus de 10 heures par semaine), après leurs heures en clinique.
Pour les maladies graves et rares, les progrès ne peuvent venir que de la recherche
En oncologie pédiatrique, 80 à 90 % des patients belges sont soignés dès leur diagnostic dans le cadre d’une étude clinique universitaire (académique).
Ces essais cliniques sont « le standard de soin » : ils garantissent aux patients l’accès aux meilleurs traitements dans l’état actuel des connaissances. Parce qu’un protocole d’essai clinique définit et standardise toutes les étapes du traitement, ces essais cliniques augmentent sensiblement la qualité des soins aux patients.
S’il existe 16 types de cancers pédiatriques, les oncologues belges doivent maîtriser et appliquer aujourd’hui plus de 50 protocoles académiques. En raison de leur grande complexité, ce travail déborde largement de leurs temps de travail, après les heures passées auprès de leurs patients. Pourtant, ces essais cliniques sont indispensables pour garantir l’amélioration continue des traitements administrés aux jeunes atteints d’un cancer.
→ Pour en savoir plus sur l’étude
« Quand vous choisissez de devenir oncologue pédiatre, vous savez que cela implique des longues journées à cause du nombre important de types de cancers, de la complexité des protocoles de traitement, des montagnes de tâches administratives et de l’importance de la collaboration (inter)nationale. Nous faisons cela volontiers car bien soigner nos patients est une énorme priorité. Mais c’est toujours un peu pénible de vivre avec le fait que nous n’en faisons jamais assez, que les deadlines continuent à s’accumuler et qu’accepter un nouveau projet se fait toujours au coût de notre temps libre. Investir en plus de tout cela dans la recherche n’est en réalité pas très réaliste », confirme la Prof. Dr. Barbara De Moerloose, UZ Gent.
Grande motivation, malgré un manque structurel de temps
Les oncologues pédiatres font preuve d’une motivation extraordinaire pour aider leurs patients, même si la réalité de terrain s’accorde mal avec leur ambition. Le problème réside essentiellement en l’absence de temps (protégé) pour la recherche. 65% d’entre eux recommanderaient cette spécialité médicale à de futurs médecins, 64% souhaiteraient consacrer plus de temps à la recherche. En théorie, ils peuvent consacrer 22% de leurs temps de travail à la recherche. En pratique, ce temps est absorbé par les soins aux patients, les tours de garde et le travail administratif. Conséquence : ils effectuent leurs recherches pendant leur temps libre.
« Cette enquête a démontré l’énorme motivation des oncologues pédiatres mais aussi la fragilité actuelle du système », dit Delphine Heenen de KickCancer. « Nous ne pouvons pas nous résigner à une situation où l’innovation dépend de sacrifices personnels. Pour mieux guérir les enfants atteints d’un cancer, avec des traitements plus efficaces et moins toxiques, il est impératif d’offrir un soutien structurel aux personnes qui effectuent la recherche ».
Plus de 40% des répondants consacre 2 à 5 heures par semaine à la recherche pendant leur temps libre. Pour 30% d’entre eux, cela monte à 5 à 10 heures par semaine, voire, chez 14%, à plus de 10 heures par semaine.
Un travail particulièrement complexe qui requiert une grande spécialisation
La problématique n’est pas uniquement liée au temps de travail. L’oncologie pédiatrique est une des disciplines les plus complexes en médecine, qui compte plus de 16 types et de nombreux sous-types de cancers pédiatriques, des traitements et des besoins de recherche spécifiques.
« Il ne s’agit pas uniquement du nombre de patients par médecin, », explique Pierre Mayeur de la BSPHO. « En oncologie pédiatrique, le nombre absolu de patients est plus bas que chez les adultes, mais la complexité est particulièrement importante. Des petites équipes de 3 à 7 médecins doivent aujourd’hui se spécialiser dans tous les types de tumeurs cérébrales, solides, les leucémies ou les lymphomes, du traitement à la rechute. C’est difficilement tenable. »
Ceci souligne l’importance d’équipes plus larges, où les médecins peuvent davantage se spécialiser dans certaines maladies au profit des patients et de la recherche.
Ce qui fonctionne : inspiration auprès de nos voisins
La recherche sur les cancers pédiatriques n’a de sens qu’à un niveau supranational. Les médecins belges participent à des groupes de travail européens, ce qui est indispensable pour recruter une masse critique de patients et partager la connaissance dans ces maladies rares.
A la fin de l’enquête, des interviews ont été effectuées avec des oncologues pédiatriques de nos pays voisins, qui montrent la voie vers des modèles alternatifs :
- Au Pays-Bas, 20% du temps des médecins est protégé pour des tâches non cliniques, comme la recherche ou la gestion de projets internes.
- En France, les oncologues plus senior sont relevés d’une partie de leur charge clinique et des gardes, ce qui leur permet de libérer du temps pour la recherche.
- En France, ils ont créé la fonction d’infirmier spécialisé (infirmier•ière disposant d’une formation supplémentaire de niveau master), qui permet de décharger les médecins tout en augmentant la qualité des soins.
Une nouvelle bourse pour soutenir les mi-temps recherche
De cette étude, il ressort un clair besoin urgent de permettre à plus d’oncologues pédiatres de bénéficier de temps protégé pour la recherche.
C’est pour cela qu’en 2025, KickCancer a conclu un accord de collaboration avec le Fonds National de Recherche Scientifique (FNRS, recherche francophone) et le Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO, recherche flamande) pour offrir à deux oncologues pédiatres belges la possibilité de libérer 50% de leur temps en clinique à des fins de recherche.
Grâce à cette bourse, l’hôpital du médecin sélectionné percevra une compensation de 70 000 euros pour recruter un oncologue pédiatre à mi-temps pour reprendre le travail clinique. Les lauréats percevront en outre jusqu’à 10 000 euros de « bench fees » pour financer leurs voyages de recherche ou du matériel de laboratoire.
Le processus de sélection est en cours et les deux lauréats seront annoncés fin mai 2026. Au total, ce sont 320 000 euros investis par KickCancer sur deux ans, renouvelables quatre fois (jusqu’à 10 ans au total).
Plan Cancer National : des recommandations constructives avec un impact immédiat
KickCancer et la BSPHO ont soumis des recommandations jointes pour le Plan Cancer National en cours de développement. Ces recommandations auront un impact direct sur la recherche et l’expertise en hémato-oncologie pédiatrique en Belgique :
- Un financement structurel pour les études cliniques académiques ;
- La reconnaissance d’une Consultation Oncologique Multidisciplinaire (COM) nationale en oncologie pédiatrique ;
- La mise en place d’un financement pour la cellule de coordination de la BSPHO.
Conclusion
« Quiconque souhaite améliorer les traitements offerts aux enfants atteints d’un cancer ne peut pas compter sur les heures supplémentaires bénévoles des médecins, » conclut KickCancer. « Ce modèle n’est tout simplement pas durable ».
À LIRE AUSSI :










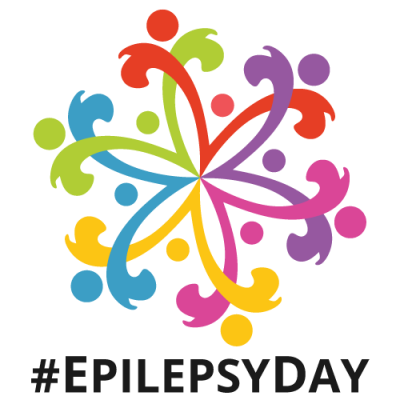 Les risques liés à l’épilepsie
Les risques liés à l’épilepsie
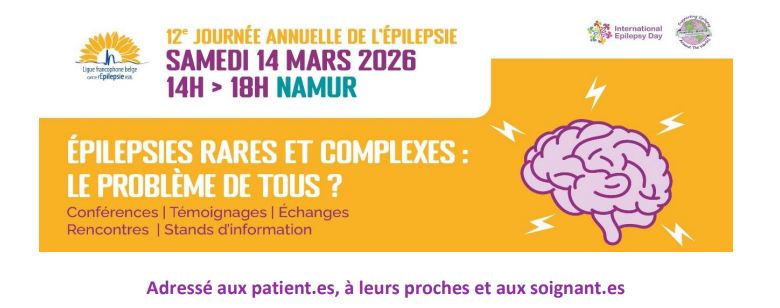 Événement : 12e journée annuelle
Événement : 12e journée annuelle